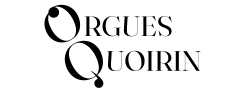Nos réalisations

SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME - Basilique Sainte-Marie-Madeleine
Orgue : 4 claviers , pédalier - 41 jeux
Grand orgue construit par Jean Esprit Isnard en 1771, restauré en 2017.
Texte de Thierry Semenoux, Maître d’œuvre de la récente restauration :
L’orgue J.E. & J. Isnard de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin, célèbre, et célébré dans tout le monde musical national et international nous est parvenu dans un état de relative bonne conservation de son esthétique architecturale, décorative, mécanique et sonore. Ceci a été rendu possible par certaines circonstances historiques et économiques, mais également grâce à la place que cet instrument monumental a eu dans l’attachement de la population à son patrimoine et ceci à travers le temps. Sauvé des besoins matériels qu’imposait le siège de Toulon au Général Bonaparte par la ferveur toute patriotique de l’organiste de l’époque, autant que par l’idylle qui se nouait entre Lucien Bonaparte et la fille de l’aubergiste local,

L’orgue put ainsi franchir une étape périlleuse de sa longue histoire. Tout au long du XIXème siècle, certes à des degrés divers, on note le souci presque constant de la Municipalité, devenue propriétaire des lieux et de l’orgue après le départ des Dominicains, de pourvoir au traitement d’un organiste pour que l’orgue soit maintenu en bon état de marche. La restauration du couvent sous l’impulsion Père Lacordaire, feront se cohabiter des organistes religieux et un ou deux organistes civils, homme ou femme jusqu’au nouveau départ des religieux pour Toulouse en 1957.
La fin des années 1950 et les années 1960 verront la redécouverte de l’orgue par le milieu musical et auraient pu causer sa perte ou tout du moins une dégradation irrémédiable. Des projets de « modernisation » voient le jour : ajout d’un plan sonore expressif, mise au diapason moderne, changements de jeux, etc… Heureusement, tous ces projets resteront lettre morte.
À la fin des années 1960, le Facteur d’orgues Pierre Chéron réalise un relevage qui permettra à l’orgue de devenir un des acteurs centraux du renouveau baroque qui s’annonce un peu partout en Europe. C’est la grande époque des académies d’été avec les pionniers d’alors, Michel Chapuis, L.F. Tagliavini, Francis Chapelet, Anton Heiller, André Stricker, Marie-Claire Alain, Xavier Darasse, etc….
Il faut attendre la fin des années 1980 et le début des années 1990 pour qu’une première restauration de l’instrument soit entreprise par étape. Le travail est confié au facteur d’orgues Yves Cabourdin. Celui-ci, entouré d’une commission du suivi très interventionniste, remplit un programme de travail qui évolue avec le temps et doit s’adapter au mieux aux contraintes de tous ordres. Il reconstitue la partie mécanique de l’orgue d’Isnard qui avait été transformée à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle (claviers, mécanique du positif), reconstruit les réservoirs cunéiformes en suivant les tracés d’origine sur le mur occidental, restaure le double abrégé des plans sonores de Raisonnance et de Grand-Orgue, restaure les sommiers, renforce la structure de l’instrument. Aucun travail sur la tuyauterie, n’est cependant réalisé, celle-ci sera reposé telle quelle et simplement accordé.
En 2013-2014 apparaît dans l’orgue une infestation massive d’insectes xylophages, en particulier au niveau des soufflets cunéiformes a rendu nécessaire une intervention de traitement et de prévention. Nous étions à un quart de siècle après les travaux achevés en 1991. Il était temps et normal d’envisager alors un « relevage ».
Après appel d’offres dans le cadre du Code des Marchés Publics, les travaux ont été confiés à l’atelier Pascal Quoirin, de Saint-Didier dans le Vaucluse.
La Restauration 2017
Texte Pascal Quoirin -facteur d’orgues.
Précision :
« Raisonnance » et non Résonnance. « Raisonnance » est la véritable orthographe figurant dans les textes attribués à Jean-Esprit Isnard.
Le marché que nous passons avec le propriétaire de l’instrument, la ville de Saint Maximin, s’intitule « relevage ». Un relevage d’orgue est une intervention simple qui consiste à dépoussiérer, corriger d’éventuels dysfonctionnements, et, pour finir accorder l’instrument. Or, Il est apparu, dès le début de cette opération, que le simple relevage n’aurait pas suffi pour aboutir à l’objectif fixé au cahier des charges. En facture d’orgues, prévoir, définir, quantifier et chiffer des travaux à réaliser est une tâche difficile et complexe, plus encore lorsqu’il s’agit de restauration d’orgues historiques. Pour pouvoir le faire dans des conditions optimales, il serait nécessaire de démonter et examiner en détail toute la tuyauterie, de faire un examen très approfondi de toutes la partie instrumentale, en un mot, ouvrir un chantier d’études préalables suffisamment complètes, lesquelles, on peut le comprendre aisément, ne peuvent être prises intégralement en charge par le seul technicien conseil. Il s’agit déjà là, de facture d’orgues. Le technicien conseil, M.Thierry Semenoux, agissant en qualité de Maître d’œuvre a tout de suite saisi l’importance de l’enjeu qui s’impose pour un tel instrument connu du monde entier et pour lequel il n’aurait pas été concevable que le travail de restauration ne soit pas totalement abouti. La ville de saint Maximin et la Direction Régionale des Monuments Historiques n’ont pas hésité à mettre en place les moyens supplémentaires pour rendre possible un parfait achèvement du programme de restauration. Le monde de l’orgue leur doit ici une reconnaissance sans faille.
L’orgue de saint Maximin ne posait aucun problème touchant à sa réalité historique, il possède pratiquement 99% de sa tuyauterie d’origine, ses sommiers et la plus grande part des transmissions, jeux et notes. La problématique de cette dernière restauration concernait surtout l’intégrité du matériel et sa remise en ordre afin d’aboutir, comme je l’ai déjà annoncé plus haut, au résultat attendu par tous.
Nous avons en premier lieu dressé un constat général de l’état de l’instrument. Celui-ci mentionne en résumé, un accord général fortement dégradé, une harmonisation très inégale pour certaines régions sonores de certain jeux (Montre16p, Flûte 16p Raisonnance, Flûte 8p Raisonnance, Montre 16p Grand-Orgue, Montre 8p, Prestant 4p), de nombreux désordres dans l’harmonisation des grands tuyaux de 16p en Montre (tuyaux sur l’octave, tuyaux muets, anormalement faibles etc..), des plein-jeux d’une justesse fortement dégradée, une cymbale de positif quasi inaudible et d’un acuité anormale, beaucoup d’inégalités dans les jeux d’anches. Toutes sortes de désordres qui ont été mentionnés dans un rapport annexé au document final détaillant la description des travaux exécutés.
Mais, paradoxalement, du fait d’une acoustique réellement exceptionnelle, l’ensemble produisait toujours cette magie sonore si particulière et unique qui contribue pour une grande part, à la réputation de cet instrument.
Il n’a pas été possible de relever le type de tempérament qui avait été posé lors de la dernière intervention de 1992. D’après les nombreux enregistrements qui furent édités après celle-ci, force est de constater qu’il s’agit en fait d’un tempérament quasi égal, ceci malgré la fausseté générale de l’instrument qui curieusement ne semblait pas vraiment gêner les organistes auteurs de ces enregistrements.
Notre constat s’est aussi porté sur l’état réel de la tuyauterie, constat impossible à faire sans un démontage complet : Tuyauterie mal implantée sur les sommiers, tuyaux en dévers systématique entraînant de profondes mutilations et déformations des pieds, de la géométrie des bouches, du fraisage des bouts de pieds lesquels provoquaient de nombreuses fuites. Nous avons aussi constaté des séries de bouches anormalement hautes (au carré pour certains tuyaux de grande quinte 5 1/3 !), de trop courtes rallonges des corps en plomb laminé, soudées avec cordon large et épais, trop proches de la longueur définitive, rendant le geste d’accord impossible sans risquer d’affaisser les bouches.
Sur le plan mécanique, mise à part le placage des claviers fortement usé, l’état général était réellement satisfaisant. On notait toutefois, une attaque des xylophages particulièrement importante sur les souffleries, celle-ci étant réalisée en peuplier (bois très apprécié des xylophages !) choix du bois imposé en 1992 par la commission du suivi des travaux et contre l’avis défavorable du facteur Yves Carbourdin qui souhaitait, à juste titre, qu’elle soit réalisée plutôt en pin ou épicéa.
Les travaux ont donc porté essentiellement sur la tuyauterie, celle-ci n’ayant en fait jamais été restaurée, les interventions du facteur Pierre Chéron depuis les années 1960, ayant surtout consisté en divers tâtonnements et expériences sur le matériel sonore pour tenter de retrouver une vérité historique hypothétique. Il fit également une analyse assez complète de toute la tuyauterie, objet par la suite d’une publication. Celle-ci comporte des séries de mesures tels que les diamètres extérieurs et intérieurs des tuyaux, des dessins des hauts des tuyaux, les épaisseurs des languettes etc. des longueurs de corps et diverses autres descriptions.
Ce relevé de Pierre Chéron est aujourd’hui à prendre avec précaution. La raison en est qu’au cours du reclassement de ce matériel nous avons découvert de nombreux désordres dans la progression des rangs, constaté des permutations entre les divers rangs des cornets, des mélanges également entre les rangs des plein-jeux ce qui, lors des dernières interventions ont nécessité à l’époque, des rallonges inutiles des corps et la recoupe de tuyaux vraisemblablement à leur longueur d’origine. Beaucoup de bouches montées et très déformées ont été aussi remarquées. Il manque également dans ce document, le relevé d’un paramètre à notre avis important : le diamètre de l’ouverture des pieds.
Après un reclassement rigoureux les opérations de restauration ont consisté en :
- Réfection des rallonges trop près de la longueur finale rendant l’accord est impossible sans affaissement du corps.
- Rallonge des corps trop courts (environ Les 2/3 de la tuyauterie a dû être rallongé)
- Mandrinage des corps, redressage des pieds pliés ou fortement courbés
- Réfection de tous les fraisages des pieds,
- Rectification des hauteurs de bouches en appliquant le paramétrage des tuyaux acceptés comme témoins d’origine.
- Soudures des déchirures.
- Changement de toutes le languettes en Chrysocale n’étant pas celles d’origine,
- Restauration intégrale des tuyaux de bois dont beaucoup étaient muets.
Le métal de cette tuyauterie est parfaitement sain. Il n’y aucune trace quelconque de lèpre. La facture de ces tuyaux est splendide, montage corps pieds parfait, épaisseur des corps bien maîtrisée, géométrie des bouches sans aucun défaut, soudures de la meilleure qualité qui soit. Les biseaux sont tous dans l’ensemble intacts, parfois très peu de dents (incisions très fines au bas du talus). Les tuyaux de façade ont posé quelques problèmes. Pour quelques-uns, le manque d’épaisseur par endroit, notamment les grands tuyaux, rend le fonctionnement difficile. Il a donc été nécessaire de les corriger par intégration de nouvelles plaques sur les zones incriminées.
Toute cette tuyauterie a été replacée et réajustée sur les sommiers de manière à être droite sans dévers possible. La troisième octave de Montre de 16p, de Flûte 16p Raisonnance, la deuxième octave de Montre 8p et Flûte 8p Raisonnance, la première octave de Prestant 4p et première octave de Flûte 4p Raisonnance, ont été refaites à neuf en copie Isnard. Ces nouveaux tuyaux remplacent des tuyaux de bois Isnard de facture et progression de tailles discutables, produisant d’importants écrans acoustiques dans l’orgue. Ces tuyaux de bois, manifestement implantés provisoirement par Isnard lui-même à la fin de son chantier en 1772 par manque probable de moyens financiers, ont été positionnés à l’intérieur du buffet sur des pièces porteuses. Cet acte de restauration est donc réversible, mais il a permis de créer un équilibre d’harmonie absolument indispensable au « Fond d’orgue » et une assise stable pour le plenum.
Une intervention particulière a été faite également en ce qui concerne la cymbale du positif. Celle-ci a été constatée au démontage d’une acuité anormale puisqu’elle plafonnait au 1/16ème de pieds ! L’examen des tuyaux a fait apparaître une anomalie de taille importante en ce qui concerne les deux octaves du dessus des 3 rangs. En comparant ces tuyaux à ceux du même diamètre de la Cymbale du Grand-Orgue, nous en avons conclu qu’ils ont été fortement recoupés (une octave pour la plupart). Cette anomalie avait déjà été mentionnée par Jean Fellot dans son ouvrage traitant du Plein-Jeu Français paru dans les années 1960. Cette cymbale, autrefois inutilisable et qui curieusement n’avait fait l’objet d’aucune remarques particulières de la part des organistes, a donc été recomposée et les tuyaux rallongés. Elle complète maintenant l’ensemble du plenum.
Le ton retrouvé est celui d’une moyenne générale entre tuyaux d’anches à leur point à une température de 18° et tuyaux de fonds admis comme témoins d’origine : à 18°C : 397,5 Hz
À 15°C : 395,1 Hz
Le tempérament posé est un dérivé de Mésotonique. Il est quatre tierces justes : A/C#, E /G#, D/F#, G/B, trois tierces ralenties, F/ A, Bb/D, C/E. Il se trouve qu’à ce tempérament, les tuyaux acceptés comme d’origine s’intègrent bien dans cette disposition des intervalles. Mais il faut cependant convenir qu’il serait impossible d’affirmer qu’il s’agit là du tempérament d’origine et c’est probablement le cas pour toutes les restaurations d’orgues historiques.
Conclusions
Cet orgue unique est constitué de presque 100% de sa tuyauterie d’origine. Son organisation instrumentale avec le concept du plan de Raisonnance accouplé au pédalier en fait une œuvre d’une intelligence singulière qui le différencie de toute la production des grands orgues construites au 18ème siècle. Sa réalisation, qui s’est progressivement affinée (d’abord un instrument de 8p qui finira en un grand double 16p en façade) aboutit à une œuvre magistrale et très moderne pour l’époque.
L’économie de matière utilisée aussi bien en ce qui concerne toute la partie instrumentale et les buffets est surprenante. L’impression d’équilibre produite par leur élégant tracé est bien la preuve d’une maîtrise totale de l’art de la proportion. Tout comme la génialité des chapiteaux relevés des tourelles qui témoigne d’une audace peu commune.
La partie instrumentale constituée du stricte nécessaire et avec les matériaux les plus simples ne met jamais en cause la qualité d’un parfait fonctionnement. On est très loin ici du luxe Parisien des Clicquots, Lefebvre et autres, c’est l’essentiel qui est visé avant tout, il n’y pas de superflu, tout est utile et fonctionnel.
Toute la tuyauterie, d’étain et d’étoffe, d’une haute qualité d’exécution est riche d’enseignements pour tous ceux qui ont contribué à pérenniser cet ouvrage unique. On y découvre des procédés ingénieux et simple pour l’établissement des tailles comme par exemple celles des principaux 16p, 8p et 4p du Grand Orgue que l’on peut opposer au Flûte 16p, 8p et 4p, du clavier de Raisonnance, tuyaux exactement identiques mais dont la couleur sonore très différente est principalement le fait d’un d’alliage du métal plus riche en plomb. Ou encore, la similitude des mesures de la Doublette du Positif et de la Quarte du Nasard de qui se différencie uniquement en ce qui concerne cette dernière par des bouches plus basses et un paramétrage d’embouchage à l’opposé de la Doublette. On constate le même procédé entre la Montre 8p du Positif et la Flûte 8p de ce clavier.
Tout ce matériel sonore, mis à part le Larigot du Positif lui-même constitué de tuyaux de diverses provenances mais cependant ancien (18ème), est clairement identifiable. On peut en effet constater à la base du pied de chaque tuyau, un tracé particulier encore bien visible. Il s’agit d’une méthode particulière pour définir la conicité du pied avant sa mise en forme sur un mandrin. Ce tracé (un cercle) est la conséquence d’une méthode rapide et très rationnelle de fabrication. L’attribution de tous ces tuyaux à Isnard est donc sans équivoque. On retrouve ces mêmes traces sur la tuyauterie ancienne de l’orgue de Lambesc tout comme sur celle de l’orgue de l’église de la Madeleine à Aix en Provence.
Tout cet ensemble sonore diffère nettement des usages en cours dans la deuxième moitié du 18ème siècle, il n’y a rien de semblable par exemple dans l’orgue Dom-Bedos de Bordeaux., Jean Esprit Isnard et son neveu Joseph sont plus modernes, plus inventifs, plus audacieux et cela, malgré les risques encourus par les conséquences de leurs inventions. L’ordonnance chromatique des sommiers par exemple, procédé vivement déconseillé par Dom-Bedos, la réalisation très particulière des jeux d’anches dont la progression de la taille des rigoles décroît d’une manière totalement différente de ce que l’on trouve chez Clicquot, Lépine ou encore Dom-Bedos, l’étroitesse des sommiers qui aboutit à une promiscuité des tuyaux, favorable à la fusion des timbres mais redoutable pour la stabilisation de l’accord, tous ces partis pris assumés et maîtrisés font de cet orgue l’œuvre unique et majeur de la facture française du 18ème siècle.
Pascal QUOIRIN – Facteur d’orgues
Mardi 17 septembre 2019
Composition :
| Positif de dos Etendue : CD1-D5 (50 notes) | Grand-Orgue Etendue : CD1-D5 (50 notes) | Résonance Etendue : CD1-D5 (50 notes) | Récit Etendue : G2-D5 (32 notes) |
| Montre 8 | Montre 16 | Flûte 16 | Cornet V |
| Bourdon 8 | Bourdon 16 | Flûte 8 | Trompette 8 |
| Flûte 4/8 | Montre 8 | AFlûte 8 (D) | Hautbois 8 |
| Prestant 4 | Bourdon 8 | Flûte 4 | |
| Nazard 2 2/3 | Gros Nazard 5 1/3 | Cornet V (D) | |
| Quarte de Nazard 2 | Prestant 4 | Bombarde 16 |
|
| Doublette 2 | Grosse tierce 3 1/5 | Première Trompette 8 |
|
| Tierce 1 3/5 | Grosse fourniture II | Deuxième trompette 8 |
|
| Larigot 1 1/3 | Petite Fourniture IV | Trompette en chamade 8 (D) |
|
| Fourniture III | Cymbale IV | Clairon 4 |
|
| Cymbale III | Cornet V (D) | ||
| Cornet V (D) | Trompette 8 | ||
| Trompette 8 | Trompette en chamade 8 (D) | ||
| Cromorne 8 | Voix humaine 8 | ||
| Clairon 4 | Clairon 4 |
Accouplement Positif/G.O. – Récit/G.O.
Tirasse I, II, III et pédalier en 4 – Tremblant
Découvrez d'autres réalisations :

PARIS – Cathédrale Notre-Dame 2024

PONTIGNY Ancienne abbatiale Cistercienne (III, 33) 2023

NEUCHÂTEL (Suisse) – Collégiale Notre Dame (II, 27) 2022

LYON – Cathédrale primatiale Saint-Jean-Baptiste (IV, 68) 2022

LAMBESC – Notre-Dame de l’Assomption (III, 26) 2022